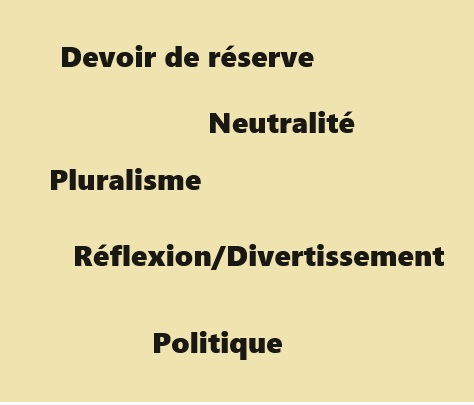Neutralité, pluralisme et responsabilité des bibliothécaires
Le 25 mai 2023 paraissait la livraison annuelle thématique Bulletin des bibliothèques de France, intitulée cette année-là Bibliothèques, objets politiques https://bbf.enssib.fr/l-annee-des-bibliotheques-2023.
J’y ai contribué avec un article intitulé « Politiques publiques et responsabilités des bibliothécaires ».
Après un embargo contractuel de 18 mois, je me permets d’autopublier en PDF le texte tel qu’il est paru alors : http://www.lahary.fr/pro/2023/lahary-aunomdelaloi.pdf [aucun danger à télécharger].
Pour respecter le nombre de signes assignés par une publication, il arrive qu’on soit obligé d’élaguer à regret. Je publie donc ici la version longue originale de ce texte :
http://www.lahary.fr/pro/2023/lahary-aunomdelaloi-versionlongue.pdf [aucun danger à télécharger].
C’est l’occasion de revisiter quelques notions évoquées dans ce texte, d’ou le présent billet que je m’efforce de rendre aussi bref que possible.
Les deux sens de la neutralité de l’agent public
La partie législative du Code général de la fonction publique1 est entré en vigueur le 1er mars 2022. Il codifie des dispositions éparpillées entre plusieurs lois tout en remplaçant le plus souvent le terme « fonctionnaire » par l’expression « agent public », ce qui inclut également les contractuels.
L’obligation de neutralité fait l’objet de l’article L121-2 revêt ici des significations précises qu’il ne fait mais confondre avec le sens vague et multiple dans lequels ce terme peut être utilisé dans le langage courant.
Cette obligation tient en quatre phrases : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».
Il s’agit donc d’une part de ne pas faire la promotion de ses opinions quand on est en service, d’autre part de traiter également tous les usagers, vaste et beau sujet, difficile quand on sait que des postures excluantes ne sont pas forcément conscientes.« Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
En bibliothèque, ces deux sens sont pleins de sens ! Mais ils convergent dans une déclinaison paradoxale : le pluralisme.
Les deux sources du pluralisme en bibliothèque
Première source : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Constitution.
Selon l’artice 11 de la Déclaration de 17892, « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme ; tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
Quant à l’article 4 de la Constitution3, il comporte cette phrase : « La loi grarantit l’expression pluraliste des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »
Elle est issue de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Conseil constitutionnel l’avait précédée en faisant du pluralisme un « objectif à valeur constitutionnelle ». Ses décisions successives concernant l’accès des citoyens à des contenus pluralistes permettent de distinguer :
- pour les organes de presse écrite, le pluralisme externe selon lequel : « la libre communication des pensées et des opinions (…) ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents4 ».
- pour les médias audiovisuels, le pluralisme interne, qui consiste à : « disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information5 ».
On reconnaît là que les bibliothèques peuvent ressortir à la fois du pluralisme externe si on songe à l’éventail des contenus à rendre accessible et du pluralisme interne si on considère comme un tout l’offrre documentaire et autres services et ou activités qu’elles proposent.
Seconde source : L’obligation de neutralité des agents publics.
S’agissant notamment des ressources documentaires, la neutralité dans sa double dimensions (égalité de traitement entre tout usager et non exposition propagandiste de ses propres convictions) conduit, non pas à une neutralisation par l’occultation, mais à une profusion par la diversité.
Le principe de pluralisme est bien une déclinaison apparemment paradoxale de l’obligation de neutralité, telle que définie dans le Code général de la Fonction publique. Ajoutons que, même si les sources constitutionnelles conduisent à associer pluralisme et politique, les bibliothèques peuvent donner à ce terme une signification globale : on peut parler de pluralisme des goûts, des genres et modes d’expression culturelle.
Comprise ainsi, la neutralité ne consiste pas à chercher à ne fâcher personne mais à risquer de choquer chacun.
Confirmation des deux sources : la loi Robert
La loi Robert, dans son article 1, définit les missions des bibllothèques territoriales : « garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que […] favoriser le développement de la lecture » avant de préciser : « ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »
Elle place donc directement l’activité de ces bibliothèques dans le cadre des principes généraux que nous venons de rappeler. Principes qui se situent dans le droit fil des références traditionnelles proprres aux bibliothécaires, qu’il s’agisse de Manifeste de l’IFLA-UNESCO dans sa version de 20226, du Code éthique de l’IFLA7 ou du Code de déontologie des bibliothécaires publié par l’ABF8.
Autonomie relative et responsabilité des bibliothécaires.
L’article 72 de la Constitution garantit la libre administration des collectivités territoriales « dans les conditions prévues par la loi ». La loi Robert fixe un cadre qui s’impose aux élus, qui ne peuvent faire de la ou de leurs bibliothèques une vitrine de leurs propres orientations alors qu’elles doivent être une vitrine de la République.
Cette loi s’impose de la même façon aux bibliothécaires tout en leur confiant une importante responsabilité. Selon l’article 7, ce sont bien « les bibliothèques » qui « élaborent les orientations générales de leur politique documentaire » (on notera ici tout le poids du pronom possessif « leur »).
Elles sont donc garantes des principes qu’elles sont censées respecter tout en étant chargées de leur interprétation et de leur mise en œuvre.
Ces « orientations générales » existaient bien sûr ici et là avant la loi, souvent sous l’appellation de « charte documentaire ». et étaient souvent publiées sur le site web de la bibliothèque ou de la collectivité.
Leur mention dans la loi, avec la recommandation d’un passage devant l’assemblée délibérante sans qu’un vote soit obligatoire, en fait un document public dont il faut recommander qu’il soit plus facilement accessible que s’il n’était consultable qu’en tant qu’annexe d’un procès verbal d’assemblée.
Il s’agit d’un élément de politique publique délégué à la bibliothèque. A ce titre, il est démocatique qu’il soit portée à la connassance du public. Ce document expose selon quels principes et en fonction de quels critères des documents sont choisis ou au contraire écartés. Il doit aider chaque équipe à choisir en cohérence et à répondre aux questions, étonnements, reproches du public ou de la hiérarchie administrative ou politique sur la présence ou l’absence de tel document ou de tel contenu, pour autant que les critères le justifiant sont explicites dans ce texte.
L’énoncé de ces critères garantit que ce qui lui est proposé ne relève pas des goûts et opinions des bibliothécaires, selon un préjugé encore trop souvent répandu, mais relève d’une démarche professionnelle répondant à des principes généraux et conforme à une déontologie.
Il ne s’agit évidemment pas d’une science exacte et il est normal de tâtonner, de bricoler, de rectifier. C’est à chaque équipe d’entreprendre, si ce n’est pas fait, ou de remettre sur le métier sa propre démarche de production de ses « orientations générales », en se gardant de copier un texte passe-partout ou de se contenter de brèves formules trop générales.
Nous conclurons par cette phrase :
Publier les orientations générales de la politique documentaire
est une nécessité démocratique et une protection professionnelle.
1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2022-03-01
2 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
3 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
4 Conseil constitutionnel, décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84181DC.htm.
5 Conseil constitutionnel, décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/93333DC.htm.
6 « Fournir l’accès à un large éventail d’informations et d’idées, libres de toute censure ». Manifeste La bibliothèque est une affaire publique, 2022, https://www.abf.asso.fr/6/219/247/ABF/manifeste-la-bibliotheque-est-une-affaire-publique.
7 Code éthique de l’IFLA pour les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information, https://cdn.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/frenchcodeofethicsfull.pdf
8 « Ne pratiquer aucune censure, garantir le pluralisme, l’esprit encyclopédique et l’actualité des ressources, collections et services ». Code éthique IFLA, 2022,


 C’est le titre de la
C’est le titre de la