Dans la tourmente, quelques principes et notions comme repères
L’annonce surprise de la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République dimanche soir 9 juin a plongé le pays dans la stupeur. Chacun est obligé d’envisager comme probable un gouvernement composé de membres du Rassemblement national et de ses alliés.
Comme beaucoup d’autres, les bibliothécaires se sont posé de multiples questions. On en trouve trace sur les réseaux sociaux et c’est leur vertu que de rendre visible, écrit et archivable ce qui auparavant étaient cantonnés à une l’oralité. Je me permets d’apporter ici ma contribution à ce qui est une réflexion collective en mode accéléré, comme l’est cette campagne électorale imposée.
Je me suis servi pour écrire ce billet, publié de ma propre initiative et en mon seul nom, d’un post et de ses très nombreux commentaires parce qu’ils m’ont semblé représentatifs de débats actuels au sein de notre profession. Au préalable, je note que le RN n’est pas un parti comme un autre. Son histoire et ses programmes successifs posent un problème particulier aux bibliothèques. Un gouvernement RN disposant d’une majorité parlementaire pourrait changer des lois et influer sur la gestion de la BnF, de la BPI ainsi que sur la politique de subvention pilotée par les DRAC. Pas de conséquence immédiate (sauf celle qui découlerait de la loi et de l’action de l’exécutif) sur les collectivités territoriales… jusqu’aux prochaines municipales (2026).
Les impacts directs d’un pouvoir national du RN peuvent porter atteinte aux fondements même de notre République. Je me contenterai de ces deux seuks exemples : La préférence nationale (actuellement inconstitutionnelle) et l’interdiction des signes religieux dans l’espace public pourraient créer des obligations dans les conditions d’accueils des publics en bibliothèque. En outre, Il est possible le déchaînement de comportements désinhibés allant de la discrimination aux agressions qui pourraient toucher jusqu’aux lieux de bibliothèques.
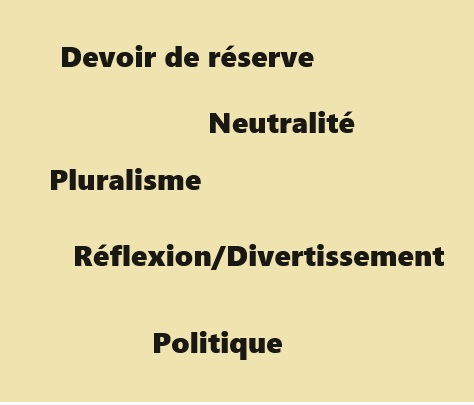
Devoir de réserve : Pure création de la jurisprudence, il ne concerne que les propos publics en encadrant la liberté d’expression des agents publics en dehors du travail, alors que la liberté d’opinion leur est garantie par la loi. La jurisprudence fait appel à la notion de modération dans l’expression mais comme il ne s’agit que d’un éventuel motif disciplinaire, il ne concerne que la collectivité employeuse. Si c’est l’État, la question est plus complexe. Chacun reste pourtant libre de militer pour les causes qui lui conviennent en dehors du travail, y compris dans des engagements publics.
Références
- Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique, site servicepublic.fr, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F530
- Guide du devoir de réserve et de la liberté d’expression, collectif Nos services publics, 2011, à télécharger
https://nosservicespublics.fr/guide_devoir_reserve
Guide précieux qui souligne bien que le devoir de réserve ne concerne que les propos tenus à l’extérieur du service. Certaines références législatives sont obsolètes car depuis est paru le Code général de la fonction publique. - L’obligation de réserve des agents territoriaux en 10 questions, La Gazette des communes, 2022
https://www.lagazettedescommunes.com/35304/l%E2%80%99obligation-de-reserve-des-agents-territoriaux-en-10-questions-2/ (réservé aux abonnés)
Neutralité : Oublions les multiples sens de ce mot dans le langage courant qui mène à des fausses pistes, il s’agit ici du devoir de neutralité tel qu’il est défini dans la partie législative du Code général de la fonction publique. Il comporte deux volets complémentaires. Le premier c’est l’obligation d’égalité de traitement de chaque personne, ce qui interdit la moindre discrimination : voilà un principe très intéressant dans le contexte qui nous soucie ! Le second qui en est l’évident complément, c’est l’interdiction pour les agents public de se servir de leur fonction, lors du contact avec le public, pour promouvoir leurs propres idées ou croyances. Ce principe essentiel du service public en général concerne évidemment les bibliothèques et la loi Robert l’a rappelé qui proclame que les missions des bibliothèques « s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. » Cela oblige aussi les élus et interdit à une municipalité de faire de sa bibliothèque une vitrine de ses idées comme cela a été mis en place par certaines municipalités dans les années 1990. Le code éthique d’IFLA associe la neutralité à l’impartialité.
Références
- Code général de la fonction publique, article L121-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420671/
- Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique, site servicepublic.fr, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F530
- Laïcité et neutralité de la fonction publique, portail fonctionpublique.gouv.fr, 2022-2024, https://www.fonction-publique.gouv.fr/etre-agent-public/mes-droits-et-obligations/laicite-et-neutralite-de-la-fonction-publique
- Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique dite loi Robert, article 1, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537514
- La notion de service public, site vie-publique.fr, 2:quels sont les grands principes du service pubic
https://www.vie-publique.fr/fiches/20223-la-notion-de-service-public
« Le défaut de neutralité – principe qui est un prolongement du principe d’égalité – d’un agent du service public, par exemple une manifestation de racisme à l’encontre d’un usager, constitue une faute déontologique grave » - Code d’éthique de l’IFLA pour les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information, 2012, https://cdn.ifla.org/files/ assets/faife/codesofethics/frenchcodeofethicsfull.pdf
« Les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information sont strictement tenus à la neutralité et à l’impartialité concernant les collections, les accès et les services. [… Ils] font la distinction entre leurs convictions personnelles et leur devoir professionnel. »
Pluralisme : En bibliothèque, c’est évidemment une déclinaison du devoir de neutralité qui en l’occurrence n’est pas la grisaille mais la profusion. Cela concerne tous les domaines, notamment culturels, mais en politique il faut le mettre en relation avec la notion de principe à valeur constitutionnelle forgée progressivement par le Conseil constitutionnel sur la base de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. De même que les médias audiovisuels doivent respecter une équité entre les courants politiques, ce qui n’est pas une mince affaire, de même, comme le proclame la loi Robert les collections « représentent […] la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales ». Les équilibres l’ont pas à varier au gré des opinions des élus,des bibliothécaires ou de la majorité des électeurs de l’endroit, ni à compenser par leur déséquilibre un déséquilibre constaté ailleurs. Toute bibliothèque est à cet égard une vitrine de la République.
La loi Robert indique que « les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire. » Un tel document doit présenter les principes selon lesquels les choix sont faits. Si des contenus sont exclus il doit énoncer selon quels critères ils le sont. Il est démocratique que la politique documentaire soit portée dans ses grandes lignes à la connaissance du public, selon la belle formule de l’article 15 de la déclaration de droits de l’homme de 1789 qui fait partie de notre Constitution : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Références
- Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique dite loi Robert, articles 1 et 5, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537514
- Code d’éthique de l’IFLA pour les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information, 2012, https://cdn.ifla.org/files/ assets/faife/codesofethics/frenchcodeofethicsfull.pdf
« Les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information sont strictement tenus à la neutralité et à l’impartialité concernant les collections, les accès et les services. [… Ils] font la distinction entre leurs convictions personnelles et leur devoir professionnel. » - La démocratie, fiche du Conseil constitutionnel, s.d.,
https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/18609/pdf
Selon le Conseil, le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions ainsi consacré « est un fondement de la démocratie » (décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017).
Réflexion versus divertissement. Nous en arrivons là aux missions des bibliothèques. Elles sont définies dans la première phrase du premier article de la loi Robert : « garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que […] favoriser le développement de la lecture » Il y a à la fois le loisir et la culture, l’information (pas la désinformation), les savoirs (pas les pseudosciences). Le Manifeste IFLA.UNESCO sur la bibliothèque publique mentionne dans ses missions aussi bien « fournir l’accès à un large éventail d’informations et d’idées, libres de toute censure » que « offrir des possibilités de développement créatif personnel, stimuler l’imagination, la créativité, la curiosité et l’empathie ». Il n’y a aucune raison d’opposer le divertissement et la réflexion, les deux sont dans les missions. Selon le Code de déontologie des bibliothécaires republié par l’ABF en 2020, « le personnel des bibliothèques veille à ce que la pluralité des ressources favorise l’autonomie de chacun, en recherchant l’objectivité et l’impartialité, et en respectant la diversité des opinions. Dans ce sens, il s’engage dans ses fonctions à mettre à disposition des publics l’ensemble des ressources et méthodes nécessaires à la construction d’une pensée complexe et autonome : compréhension éclairée des débats publics, de l’actualité, des grandes questions historiques, philosophiques, scientifiques et sociétales ». Voilà une belle mission loin de toute propagande. Et qui autorise bien évidemment à organiser des actions ou à mettre en avant des contenus en rapport avec divers aspects de l’actualité.
Références
- Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique dite loi Robert, article 1, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537514
- Manifeste IFLA.UNESCO sur la bibliothèque publique, 2022
https://www.abf.asso.fr/6/46/985/ABF/manifeste-ifla-unesco-sur-la-bibliotheque-publique
Politique. Les bibliothèques sont politiques au sens où elles sont des outils de politique publique qui se déroule aux échelles nationales, régionales, départementales, intercommunales et communales, sans oublier les différents niveaux d’éducation jusqu’au supérieur. Les élus locaux définissent librement leur politique locale dans le cadre de la loi. Notamment leur politique de lecture publique qui, on le voit par la palette des missions visées dans la loi Robert, est au croisement d’autres politiques publiques :sociales, éducatives, urbaines, etc. Les personnels n’y échappent pas qui prennent chaque jour des décisions, agissent avec une certaines marges d’autonomie, non pas selon leur fantaisie pais au nom de l’intérêt public : ils sont donc des agents mettant en œuvre une politique publique, même si celle-ci n’est pas formulée. Cette action ne s’adresse pas à des « adhérents » (on n’est pas adhérent d’un service public) mais à une population dans sa diversité même si seule une partie fréquente ponctuellement ou régulièrement la bibliothèque. Représente-t-on la municipalité ? Oui dans les limites de la loi, qui pose des principes. Un maire a-t-il à dicter les orientations de la bibliothèque ? Dans une collectivité, celle-ci n’est pas un électron libre mais un service parmi d’autres qui peut s’insérer dans une politique publique globale. Mais la loi Robert délègue clairement à « la bibliothèque » la définition de « sa » politique documentaire et le principe du pluralisme s’impose à elle mais aussi à la municipalité qui ne devrait pas ordonner qu’on y déroge.
Référence
- Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique dite loi Robert, article 7, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537514
Des collègues se demandent comment alerter sur le danger que représente le RN dans le cadre de leur travail. Ma réponse est : en faisant leur travail, et c’est déjà beaucoup, dans le cadre des principes qui l’encadrent et qui sont aussi des boucliers contre d’éventuelles atteintes aux fondements de notre République. En dehors du travail, chacun est libre d’agir. Rappelons cette belle formule de l’inspecteur général Jean-Luc Gautier-Gentès dans un texte faisant partie du recueil Pour une république documentaire : « Mon bibliothécaire idéal, […] c’est un homme qui, le soir venu, quitte sa bibliothèque pour aller combattre des idées dont il a veillé,dans la journée, à ce qu’elles soient représentées dans les collections. »
Référence
- Jean-Luc Gautier-gentes, Une république documentaire : Lettre ouverte à une jeune bibliothécaire et autres textes, BPI et Centre Pompidou,2004,
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/60542-une-republique-documentaire
Référence personnelle complémentaire : Politiques publiques et responsabilités des bibliothécaires ; in Bibliothèques, objets politiques, L’année des bibliothèques, Bulletin des bibliothèques de France, 2023
http://www.lahary.fr/pro/2023/lahary-aunomdelaloi.pdf